![]() Dérailleur automatique
Dérailleur automatique
J'ai un petit vélo dans ma tête, avec trois dérailleurs automatiques, qui tiennent tous les trois du défi mécanique.
Le premier et le deuxième et le troisième
Premier dérailleur compliqué
Le dérailleur de mes rêves maintient la vitesse de rotation du pédalier
entre 2 valeurs réglables à l'aide d'une manette au guidon. Quand le pédalage
devient trop rapide, le dérailleur passe au pignon plus petit. Quand le
pédalage devient trop dur, le dérailleur passe au pignon plus grand. La
position de la manette détermine à quel moment doivent se faire les
changements. Le réglage permet d'ajuster la force et le rythme du pédalage.
C'est ainsi qu'au moment du passage en danseuse, il ne faut pas avoir
l'impression de pédaler soudain dans le vide (cette impression est fortement
ressenti avec l'assistance électrique).
L'idéal est d'utiliser l'énergie du vélo pour exécuter toutes les opérations de changement de vitesse.
Il faut donc un peu (très très peu!) d'énergie pour faire fonctionner une pendule mécanique, que l'on fera battre aux alentours d'une 1/2 seconde pour avoir une référence temporelle.
Il faut ensuite un peu d'énergie pour déplacer le guide chaîne d'un pignon au pignon supérieur et un petit peu d'énergie pour repasser au pignon inférieur. Pour ce faire, une came astucieusement mise en oeuvre peut assurer les déplacements.
Astucieusement, cela signifie que la pendule et le pédalier décident si oui ou non il faut le faire:
- Si un ergot situé sur le pédalier n'a pas réarmé un ergot avant que la pendule ait compté sa 1/2 seconde, cela veut dire que le pédalage est trop lent (soit il devient trop difficile, soit le cycliste a arrêté de pédaler), alors, il convient de passer au pignon immédiatement supérieur. L'ergot est alors poussé par une came placée sur le moyeu de la roue. Le déplacement de l'ergot entraîne le guide-chaîne vers le pignon supérieur.
- Si l'ergot a été réarmé une fois, rien ne se passe
- Si l'ergot a été réarmé 2 fois, cela signifie que le pédalage est trop rapide (le cycliste commence à avoir l'impression de pédaler dans le vide). Alors il convient de passer au pignon immédiatement inférieur pour durcir l'effort. Ce deuxième réarmement a pour effet d'effacer un autre ergot qui permet alors à un ressort d'assurer le déplacement du guide chaîne vers le pignon inférieur.
- Bien évidemment, le ressort est réarmé à chaque fois que l'on monte vers le pignon supérieur.
Il faut encore donner au cycliste la possiblité de changer le réglage en fonction de la puissance qu'il souhaite donner à son pédalage. Cela se fait en réglant la période de la pendule. Une manette de guidon permet d'allonger ou de raccourcir le balancier de façon à agir sur le battement (rapide quand le balancier est court, lent quand il est long).
Reste à fournir l'énergie à la pendule. Tout simplement, il suffit que le vélo accélère ou ralentisse pour fournir une impulsion dans un sens ou dans l'autre, non pas directement au balancier, ce qui conduirait à des changements de vitesse innopportuns, mais à un ressort à cliquet. Ce ressort assure alors l'entretien du balancement de la pendule.
Deuxième dérailleur compliqué
"Donnez moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde!", a dit Archimède.
Le dérailleur proposé fait l'inverse: "Donnez-moi un monde et un point d'appui et je vous donnerai un levier!"
- Le monde, c'est le cycliste dont l'effort se transfère à la chaîne, puis au pignon, puis à l'axe du moyeu.
- Le point d'appui, c'est le palier qui tient l'axe fixe du moyeu
- Le levier c'est celui qui va guider la chaîne d'un pignon à l'autre
Le défi mécanique, c'est l'inverse de celui du levier, qui transforme un grand déplacement en un petit déplacement. Ici, il s'agit de transformer un tout petit déplacement de moins de 1 mm en un déplacement d'un cm.
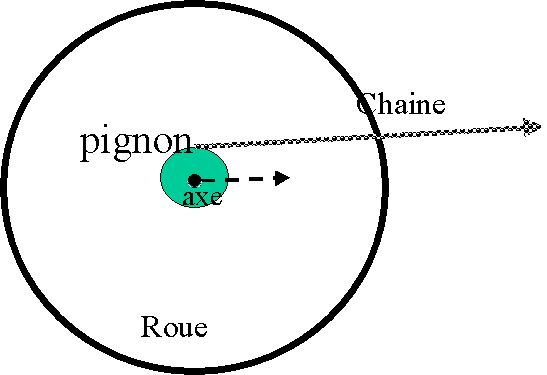
Lorsque le cycliste force sur la pédale, la chaine tire le coté droit de la roue.
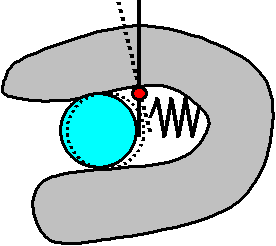
La traction de la chaîne déplace le moyeu vers l'intérieur de sa gorge de fixation, poussant ainsi un levier.
Si l'on permet à l'axe du moyeu de la roue de bouger d'un petit millimètre, tout en s'y opposant avec un ressort bien calibré, un moment viendra où la course du levier sera suffisante pour déclencher un cliquet qui à son tour déclenchera un déplacement du guide-chaîne.
Troisième dérailleur compliqué
En fait c'est un variateur de vitesse, qui utilise la propriété de certains liquides à être visqueux à fiable pression et fluides sous pression.
L'axe moteur et l'axe receveur sont liés par un roulement à bille dans une enceinte étanche.

Si les billes sont dans un liquide très fluide, l'axe receveur ne sera guère enclin à tourner à la suite de l'axe moteur. Mais si les billes sont dans un liquide presque solide, l'axe receveur ne pourra faire autrement que de suivre l'axe moteur.
Si l'axe receveur offre de la résistance à l'axe moteur, le liquide presque solide va être soumis à des pressions dans tous les sens. Sa viscosité va diminuer et l'axe receveur sera alors enclin à tourner à la suite de l'axe moteur d'autant plus vite que la viscosité sera faible.
Si un étage de roulement à bille ne suffit pas pour obtenir l'effet désiré, on peut mettre plusieurs étages intermédiaires
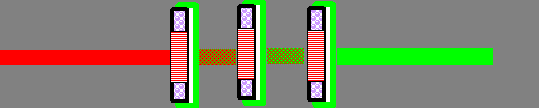
Application au vélo:
L'axe moteur est entraîné par le pédalier, l'axe receveur entraîne la roue.
A l'arrêt, aucun moment de rotation ne s'exerce entre les deux axes. Les billes du roulement à billes sont enchassées dans un liquide très visqueux.
Au démarrage, la résistance du vélo fait que le moment de rotation exerce une pression sur le fluide qui diminue de viscosité. Les deux axes ont alors un couplage visqueux qui permet à l'axe moteur de tourner plus vite que l'axe receveur, tout en lui transmettant sa puissance. La roue est entraînée et le vélo démarre.
Lorsque la vitesse de croisière est atteinte, l'énergie cinétique de l'accélération n'est plus à fournir l'accélération. Il reste à fournir l'énergie nécessaire pour vaincre la résistance de l'air et les frottements. La pression sur le fluide diminue, la viscosité augmente, le couplage se renforce, la vitesse de rotation de l'axe receveur se rapproche de la vitesse de l'axe moteur, jusqu'à un point d'équilibre.
Cet équilibre fait que le cycliste pédalera toujours avec la même puissance quelque soit la vitesse du vélo.
Cependant, tous les cyclistes n'ont pas la même puissance et un même cycliste peut vouloir pédaler de temps en temps avec vigueur et de temps en temps avec facilité. Le dosage de l'effort peut être réglé en offrant plus ou moins de couplages en série. Plus le nombre de couplages sera grand, plus la pression sera répartie et plus la viscosité sera grande. La puissance à fournir sera donc plus forte.
Une autre solution consiste à modifier la pression nominale. En augmentant la pression par un système extérieur, le pédalage sera plus facile. Ceci peut s'obtenir en faisant varier le volume de la chambre contenant les billes.